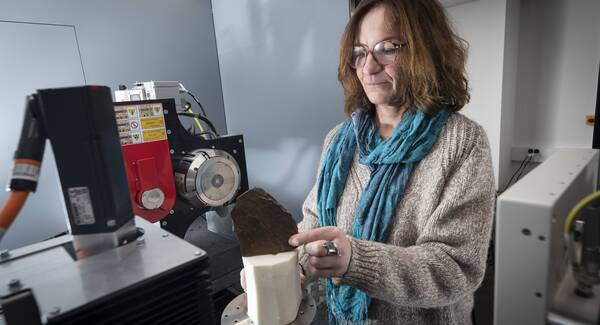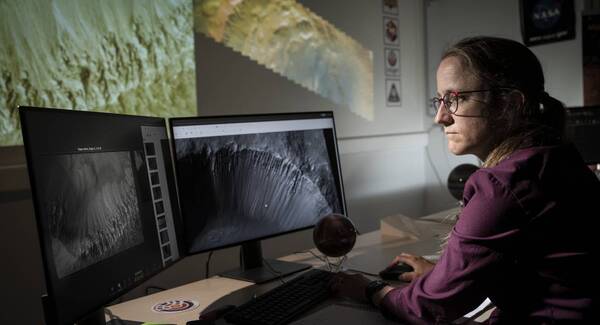La qualité de l’eau au cœur des travaux d’Émilie Jardé
Publié par CNRS Bretagne et Pays de la Loire, le 25 février 2025 170
De la Bretagne aux Kerguelen, Émilie Jardé traque les molécules organiques présentes dans l’eau. Cette chargée de recherche CNRS au laboratoire Géosciences Rennes (CNRS/Université de Rennes) au sein de l’Observatoire des sciences de l’environnement de Rennes (OSERen) remonte ensuite à leur origine, leur devenir et leur réactivité.
A
l'occasion de la journée internationale des femmes et filles de
sciences, le 11 février 2025, et jusqu'à la journée internationale des
droits des femmes le 8 mars 2025, découvrez la diversité des recherches
menées par les scientifiques du CNRS à travers une série d'entretiens.
Cette opération est labellisée Année des Géosciences 2024-2025. |
Quel est votre parcours ?
J’ai
mené des études en géologie à la faculté des sciences de Nancy, ce qui
m’a donné des bases naturalistes sur l’observation et la compréhension
des paysages. En dernière année, j’ai suivi un cours de géochimie
organique qui a été une révélation. Si cette discipline est
historiquement liée à la géochimie pétrolière, elle répond également à
des thématiques de recherche environnementale via l’analyse de la
matière organique. J’ai alors obtenu un doctorat où j’ai étudié les
matières organiques présentes dans les boues en sortie de stations
d’épuration.
J’ai ensuite effectué un postdoctorat en Oklahoma
(États-Unis) où j’ai utilisé des isotopes pour tracer l’origine de
molécules organiques, qu’elles soient naturelles ou anthropiques, dans
des eaux de surface et souterraines. J’ai été recrutée au CNRS à
Géosciences Rennes en 2006.
Qu’est-ce qui vous a donné envie d’aller vers les sciences et la recherche ?
J’ai
été attirée très tôt par les sciences naturalistes, comme la biologie
et la géologie. J’étais même fascinée par la vulcanologie. Ce qui
m’agite dans la recherche, c’est la curiosité, le désir d’observer et de
comprendre. J’aime la rigueur de la démarche scientifique et me nourrir
des échanges avec les collègues. Le collectif est primordial en
recherche. Et comme mes travaux sont très appliqués, j’ai l’impression
de contribuer à la société.
Quels sont vos thèmes de recherche ?
Je
suis un peu la « Nellie Bly » de l’eau ! Mes recherches sont ancrées
sur les questions de qualité de l’eau superficielle et l’impact des
activités humaines sur la dégradation de sa qualité, sous pressions
essentiellement agricoles, microbiologiques et chimiques tels que les
nitrates, phosphores, pesticides et biocides. D’autre part, les flux de
carbone dissous dans les (agro)hydrosystèmes peuvent impacter la santé
des écosystèmes et la santé humaine, en ayant un rôle déterminant dans
la formation de composés cancérigènes lors de la potabilisation de l’eau
ou le cotransport de polluants organiques ou inorganiques.
Les
contaminations microbiologiques des eaux représentent une des nombreuses
problématiques auxquelles sont soumis les milieux littoraux, empêchant
la baignade et contaminant les coquillages, ce qui arrive sur les côtes
bretonnes. Des molécules chimiques peuvent tracer les sources
microbiennes pour mieux identifier l’origine de ces contaminations et
ainsi les gérer. J’ai aussi travaillé au Laos, où l’accès à une eau
potable de qualité est un problème sanitaire qui perdure, ainsi qu’aux
îles Kerguelen, où je m’intéresse à la nature et à la dynamique de la
matière organique dissoute transférée par les rivières, en lien avec la
fonte des glaciers sur cette île très isolée où les transferts de
matière, vers l’océan Austral, jouent un rôle important en tant que
source de nutriments à la base de la chaîne alimentaire océanique.
Quel regard portez-vous sur la place des femmes dans votre discipline ?
Il
y a encore beaucoup de choses à faire car les femmes restent
sous-représentées en géosciences, et cela s’aggrave au fur et à mesure
que l’on monte dans la hiérarchie. Les femmes composent 35 % des
effectifs permanents du CNRS, mais seulement 30 % en géosciences, qui
impliquent souvent des travaux sur le terrain, parfois dans des
environnements hostiles ou isolés. Ces conditions peuvent décourager
certaines femmes en raison des préjugés ou des contraintes
socioculturelles, comme les questions de sécurité ou de vie familiale.
Il faut dépasser ces préjugés en mettant en avant des femmes
scientifiques qui pourront inspirer les collégiennes, lycéennes et
étudiantes à s’engager dans cette voie.
Quand je suis allée aux
Kerguelen en 2017, il y avait dix jours de bateau au départ de la
Réunion et la mission durait trois mois sur place. Un collègue masculin,
pourtant lui aussi parent et participant à la même expédition, m’a
alors dit que j’avais abandonné ma famille le temps de la mission. Ce
genre de remarque n’est pas isolée…
Heureusement, le CNRS, comme
d’autres institutions, porte des groupes de travail sur les valeurs
sociétales. Les femmes y sont cette fois majoritaires, et il faut que le
temps qu’elles y dédient soit reconnu et valorisé pour qu’elles
continuent à s’engager.
Lire la suite sur le site du CNRS en Bretagne et Pays de la Loire : https://www.bretagne-pays-de-l...